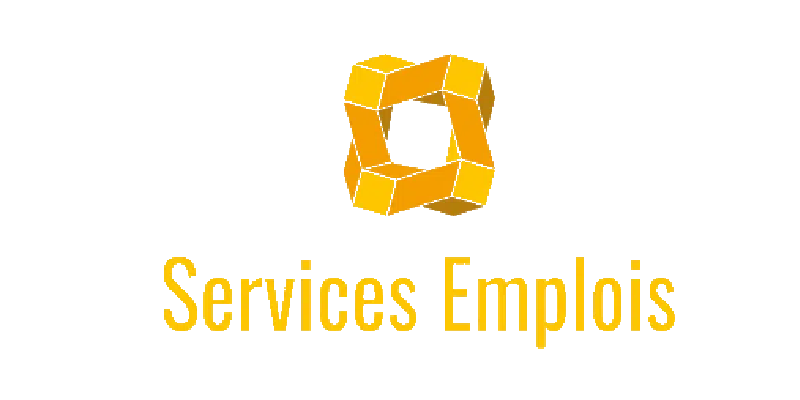Un chiffre sec, presque brutal : un agent public en arrêt maladie se voit priver de sa rémunération pour la première journée d’absence, sauf exceptions. Cette règle, revenue en force depuis 2018 après plusieurs allers-retours législatifs, continue de faire grincer des dents. Entre incompréhensions, débats sans fin et comparaisons parfois houleuses avec le secteur privé, la journée de carence s’impose comme un véritable révélateur des tensions autour du statut des fonctionnaires.
Les modalités d’application varient en fonction du statut, du motif de l’arrêt et de situations particulières. Mais derrière ces textes, une foule de questions demeure, tant sur la logique de cette mesure que sur ses conséquences très concrètes pour les agents concernés.
Comprendre la journée de carence dans la fonction publique : définition et cadre légal
Le jour de carence s’est imposé dans la fonction publique avec la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Depuis le 1er janvier 2018, tout agent public placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire perd sa rémunération lors du premier jour d’absence. Officiellement, le mécanisme vise à rapprocher public et privé, mais il laisse de côté les accidents de service (CITIS) et les maladies professionnelles.
Le jour de carence intervient dès le premier arrêt maladie d’une série, sur présentation d’un certificat médical. Si l’arrêt se prolonge sans interruption, la retenue ne s’applique qu’une fois. Tous les agents publics sont concernés, qu’ils soient titulaires, contractuels ou stagiaires, peu importe l’administration.
Voici les principales caractéristiques de cette mesure :
- Suspension de la rémunération pour la première journée d’arrêt.
- Les accidents de service et maladies professionnelles restent exclus du dispositif.
- Un seul jour de carence par épisode de maladie, même si l’arrêt est prolongé.
La loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 est venue préciser ce cadre, alors que le sujet continue de susciter débats et contestations. Le projet de loi de finances pour 2025 pourrait encore le faire évoluer, sous la pression des syndicats et des spécialistes du droit public.
Fonction publique et secteur privé : quelles différences sur la gestion des jours de carence ?
Dans le secteur privé, la règle est fixée par le régime général de la sécurité sociale. Pour chaque arrêt maladie, trois jours de carence s’appliquent avant que la Sécurité sociale ne prenne le relais. Ce délai, instauré dès 1930, vise à limiter les absences de courte durée. Certains employeurs choisissent toutefois de maintenir la rémunération pendant cette période, via des accords collectifs ou des usages internes. Selon la taille ou la branche d’activité, les pratiques varient, tout comme les solutions de protection sociale complémentaire.
La fonction publique suit une logique différente. Un seul jour de carence est appliqué à chaque arrêt pour maladie ordinaire, que l’agent soit titulaire, contractuel ou stagiaire. Les arrêts liés à un accident de service ou à une maladie professionnelle échappent à la retenue. Le dispositif reste donc plus souple que dans le privé, mais il traduit une volonté de rapprochement entre les deux régimes.
Le tableau suivant synthétise les différences entre secteurs :
| Statut | Nombre de jours de carence | Exceptions principales |
|---|---|---|
| Fonction publique | 1 jour | Accident de service, maladie professionnelle |
| Secteur privé | 3 jours | Maintien employeur ou régime conventionnel spécifique |
Le débat sur ce traitement différencié reste vif. Les syndicats dénoncent un risque de découragement, tandis que certains employeurs publics défendent la mesure comme gage d’égalité. Chaque réforme potentielle est suivie de près, tant les conséquences sur la vie des agents et l’équilibre des régimes sont scrutées.
Quels impacts concrets pour les agents publics au quotidien ?
Dans la pratique, le jour de carence signifie qu’un agent public ne touche pas sa rémunération pour la première journée d’arrêt maladie ordinaire. Cela vaut aussi bien pour les titulaires que pour les contractuels de droit public. Les absences pour accident de service ou maladie professionnelle (CITIS) restent hors champ de la mesure.
L’application ne se limite pas au salaire de base. La retenue s’effectue sur le traitement brut et l’ensemble des primes et indemnités : supplément familial de traitement, indemnité de résidence, nouvelle bonification indiciaire (NBI). Résultat : la perte peut représenter plusieurs dizaines, voire centaines d’euros selon le niveau de primes.
Concrètement, cela se traduit par :
- Un traitement réduit d’une journée en cas d’arrêt maladie ordinaire.
- Des pertes qui touchent aussi les primes et indemnités.
- La plupart des contrats de protection sociale complémentaire ne compensent pas cette retenue.
Face à cette réalité, certains agents hésitent à poser un arrêt dès les premiers symptômes, par crainte de la retenue sur salaire. Le choix de déposer un premier arrêt de travail devient une décision pesée, surtout lors des pics épidémiques. La nécessité de présenter un certificat médical dès le début, la gestion fine des dates, tout cela impose une vigilance supplémentaire, aussi bien du côté des agents que des services RH.
Historique, débats syndicaux et réponses aux principales interrogations
La question du jour de carence dans la fonction publique n’a jamais cessé d’évoluer. Instauré une première fois en 2012, supprimé deux ans plus tard, il est rétabli par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et confirmé par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023. Ces allers-retours traduisent la tension constante entre logique budgétaire et exigences de protection sociale.
Les syndicats de la fonction publique, à l’image de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, dénoncent de longue date une mesure jugée injuste et stigmatisante. Le débat se cristallise autour du risque de voir les arrêts courts se transformer en arrêts plus longs, ou sur la difficulté de concilier santé et impératifs professionnels. Les chiffres de l’INSEE indiquent une légère diminution des arrêts de courte durée depuis la réintroduction de la mesure, mais son impact sur la santé des agents reste sujet à controverse.
Les interrogations les plus fréquentes portent sur les cas d’exclusion : les arrêts pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et les maladies professionnelles échappent à la retenue. Lorsqu’un arrêt se prolonge, la carence n’est appliquée qu’une fois. Ce principe vaut aussi bien dans la fonction publique d’État que dans la territoriale, même si certaines collectivités proposent des aides complémentaires.
Les zones d’ombre demeurent : articulation avec la protection sociale complémentaire, différences d’application entre les trois fonctions publiques, incertitudes sur l’avenir du dispositif… Tout indique que la question du jour de carence restera un marqueur fort du débat public autour du statut des agents. Pour beaucoup, la page est loin d’être tournée : le sujet, lui, reste brûlant, prêt à ressurgir au fil des réformes à venir.